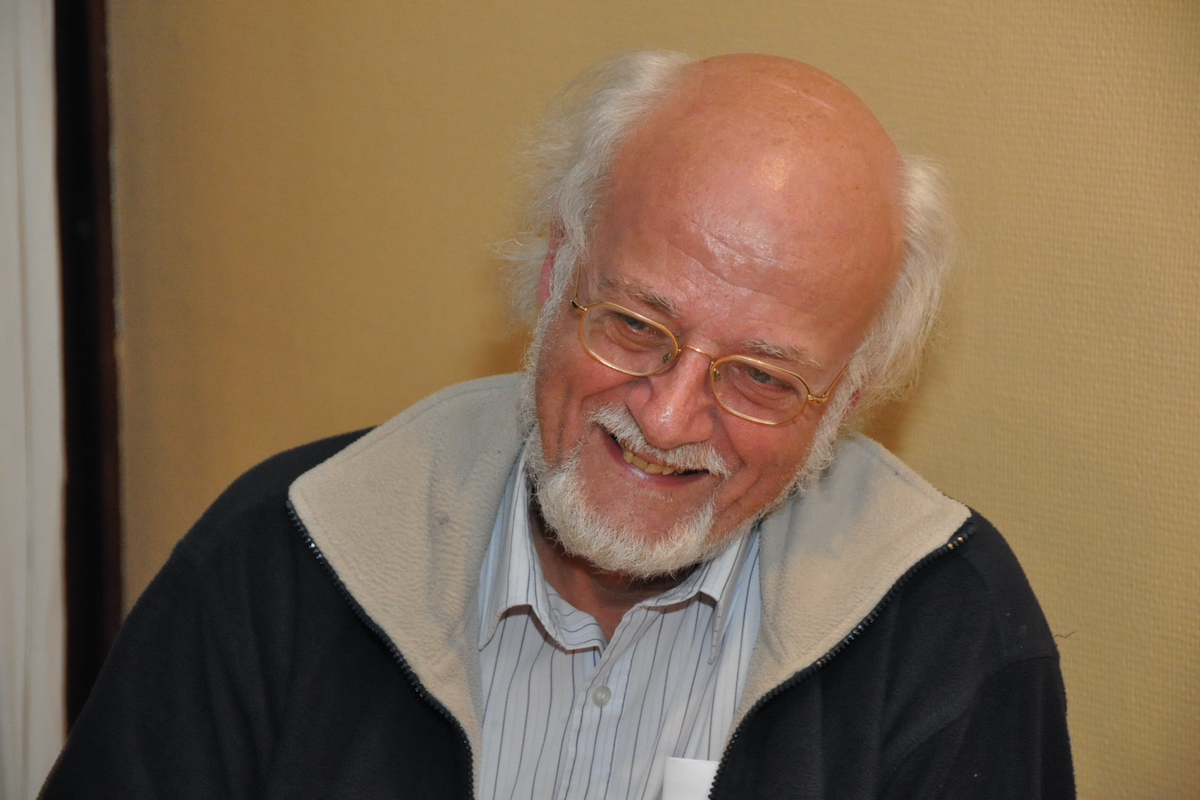Peu après la chute du mur de Berlin, j’ai eu l’occasion de passer la frontière entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Je tourne la tête 90° et je vois jour et nuit. Je me trouve dans un environnement gris, sombre, le vocabulaire français me manque. Tout évoque une monotonie écrasante. On soupçonne que l'homme y est instruit de façon très précise sur son carcan, sur ses limites, les heures, les pensées et attitudes publiques, sur ce qu'il doit vivre. Peut-être que personne n'a eu de pénurie dans cette période. Peut-être n’y avait-il pas de pauvreté. Peut-être que tout était prévu par l’état. Je l’ignore. J'avais surtout l'impression que non seulement la liberté manquait, mais la vie elle-même. Un femme me disait: maintenant que la frontière est ouverte, j’aimerais aller visiter ma famille.
Tous les systèmes politiques remontent à une notion d' "amitié" - si je puis m'exprimer ainsi, c'est à dire : sur une façon de cohabitation – de vivre ensemble. Comment allons-nous nous lier, comment nous comporter les uns envers les autres. Peut-être le communisme échoue-t-il dans la pratique parce qu'il est devenu une amitié imposée, une affection forcée, un rassemblement tenu par une main d’acier, où les relations humaines imposées ne reflètent pas de réels sentiments.
L'amitié ne peut être une relation régie par les lois d’échanges pré dessinés. Le capitalisme, cette autre genre d’amitié qui engloutit goulûment, qui séduit et divise, ne pourra pas non plus expliquer pourquoi quelqu'un veut se sacrifier pour un autre, pourquoi quelqu'un veut s’abandonner dans un autre, s’adonner gratuitement, sans autre mérité que le bien d’autrui. Où trouvons-nous un argument raisonnable qui peut expliquer "qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour autrui" ? .
La réalité du don de soi est la longue histoire du sous-entendu du Dieu d'Abraham, de Moïse, des prophètes, et est particulièrement présent et visible dans la vie du jour-au-jour de Jésus et concentré dans l'évangile de la dernière scène. Jésus vient élever et incarner l'acte quotidien de la fraction du pain et de la boisson de la coupe: il l’élève à une devise de vie. Il le condense dans le lavement des pieds et dans geste du repas pascal où il s'identifie à l'agneau sacrificiel abattu.
Que quelqu’un se donne à fond et avec passion pour écrire un livre, une biographie, pour créer une œuvre d’art, pour guérir des cancers, pour œuvrer pour le climat, pour des relations humaines respectueuses et agréables – on peut le comprendre. La passion humaine contient beaucoup d’atouts où l’on dépasse ses capacités. Les efforts des parents, des veillées des soignants, … des saintes et saint anonymes.
Mais que quelqu'un ne s'épargne pas du tout, qu'il se livre complètement à autrui, qu'il résiste malgré les accusations et menaces, qu’il reste fidèle à son Dieu et à son peuple jusqu’au bout de tout - cela me coupe le souffle. "Prends-moi, mange-moi, bois-moi". Méditant ses mots, nous sommes obligés d’admettre que pour un chrétien il n'y a qu'un seul sacrement : Jésus le Christ. Parole devenue chair. Don de soi.
La célébration de l’acte eucharistique a besoin de références à et dans la vie réelle que nous vivons. Sans ce lien, sans expériences existentielles, nous risquons de célébrer seulement de la théologie et de rater la profondeur et la vérité de la dernière scène.
Nous caressons dans notre mémoire sûrement des gestes, évènements, rencontres ou paroles qui nous ont préparé à comprendre un peu l’eucharistie. Certains gestes et attitudes de ma mère restent une clé pour moi. Et je me souviens d'un documentaire sur un médecin indien, presque un gourou, qui, un jour, tombe sur un cadavre dans la rue. Choqué, perturbé aux entrailles, il ne pouvait pas le laisser ainsi abandonné. Impossible pour lui de ne pas laver et rendre beau un cadavre – même anonyme – avant de le faire incinérer.
Laver ce corps mort a changé sa vie. Il devient l’homme qui lave les cadavres. Il fonde des dispensaires, des lieux d’abris, des cliniques, il engage des bénévoles, des professionnels, sa vocation devient une organisation avec des finances, du personnel, des relations. Et lui-même, bien que la tête de tout cela, il continue à descendre chaque jour dans la rue pour ramasser et laver lui-même au moins un cadavre. Il veut quotidiennement toucher un défunt, se rappeler et revivre sa conversion, se pencher sur l’acte difficile du don de soi. Il ne veut pas se contenter de seulement s'en souvenir.
En célébrant l'Eucharistie, nous ne nous contentons pas d’interpréter et de célébrer la réalité quotidienne de la fraction du pain, du don de soi. Dans l'Eucharistie, nous regardons aussi vers un avenir promis, mais pas encore réalisé. Il y a plus que le souvenir, l'action de grâce et la mémoire. Dans la fraction du pain, nous voyons que la vie continue vers Dieu, qui "est le pain pour tous".
Pour beaucoup de gens, il est difficile d'accepter que ce n'est qu'en Dieu que la vie sera pleinement réalisée. Que seul en Dieu il y aura "du pain pour tous". L'évêque Romero a pu dire quelques jours avant d'être assassiné : "Ils peuvent me tuer, mais on ne peut pas tuer la voix de la justice".
La validité de cette affirmation n'est possible que grâce aux Christ Ressuscité. Sans le Christ ressuscité, la déclaration de Mgr. Romero signifierait: "Il y aura toujours des gens qui – par amour pour la justice – parleront et œuvreront et lutteront "(1) . - Et c'est déjà extrêmement réconfortant ! Mais le Christ ressuscité nous permet de dire que cette justice viendra vraiment pour tous. Dans le sacrement, nous anticipons, nous recevons et nous prévoyons ce qui n'est pas encore, ce qui "sera pour nous et pour tous".
Saint Paul le dit ainsi : (citation libre avec mes propres mots) : “ Ce qui aux yeux des hommes signifie la fin d'un rêve - à savoir la mort de Jésus sur la croix - devient dans le sacrement un fondement durable de notre espérance : aucune mort ne peut encore devenir notre désespoir, notre déception, notre ennemi”.
Nombreux sont ceux qui s’affrontent – qui vivent une grande résistance - à la réalité de l'Eucharistie en tant que sacrement. Parce qu'ils trouvent injuste que la plénitude de la vie nous parviendra seulement plus tard, après la mort – et pas maintenant, visiblement. Beaucoup de gens souffrent de l’injustice de la carence. "Life is unfair - La vie est injuste" dit mon ami aux Philippines.
Pour beaucoup de gens, la justice divine arrive trop tard. On comprend donc qu’ils perdent courage et la foi, qui ne savent pas célébrer. Une maman me disait : Actuellement, je ne peux pas – je ne sais pas - participer à la messe, parce que je suis en grave dispute avec Dieu. Elle avait de sérieuses querelles avec 2 de ses filles.
Ce point difficile pour beaucoup de gens nous met, en tant que prêtres, devant un double défi, je crois.
D’une part vivre réellement à partager le pain, à boire la coupe, à vivre de manière éthique, à nous abandonner à autrui.
Et d’autre part vivre et célébrer ce que nous ne voyons pas encore, la promesse qui dit : "Je serai tout en tous - et ils seront en moi".
Et après avoir considéré tout cela, soyons maintenant politiques, vivons une politique d'amitié avec un cœur pur, selon la mesure et la démesure de notre capacité de partager notre vie.
____________________
- Schillebeeckx, Om het behoud van het evangelie. Evangelie verhalen II, Nelissen – Baarn, 1988, p.92. Cette homélie est partiellement inspiré par l’homélie de S. pour la fête du S. Sacrement, p. 91-95.